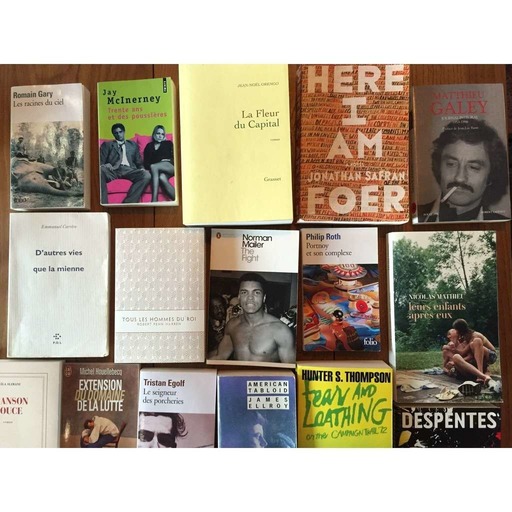« Voici l’enfant. Il est pâle et maigre, sa chemise de toile est mince et en lambeaux. Il tisonne le feu près de la souillarde. Dehors s’étendent des terres sombres retournées piquées de lambeaux de neige et plus sombres au loin des bois où s’abritent encore les derniers loups. Sa famille ce sont des tâcherons, fendeurs de bois et puiseurs d’eau, mais en vérité son père a été maître d’école. Il ne dessoûle jamais, il cite des poètes dont les noms sont maintenant oubliés. Le petit est accroupi devant le feu et l’observe. »
Après un incipit aussi sublime, il faut quatre pages à Cormac McCarthy pour présenter le personnage de l’enfant et son périple initial de vagabond, la dureté du monde des hommes et celle de la nature, la connaissance approfondie qu’il en acquiert et les forces telluriques qui cabossent ainsi sa boussole morale au risque de la fausser à jamais. Une narration à ce point véloce et puissante n’est pas qu’une question de maîtrise de la syntaxe ou d’un épais dictionnaire de synonymes. Elle requiert une rare conscience de l’essentiel, formule qui résumait à elle seule les immenses qualités de La route. On attribue naturellement cette faculté à un auteur au faîte de ses talents, ayant accumulé l’expérience patiente d’un vétéran de son art ; de fait, lorsqu’il reçut le Pulitzer de la fiction pour son chef d’oeuvre de 2007, McCarthy était septuagénaire. Mais Méridien de sang fut publié plus de vingt ans auparavant, et l’écrivain y apportait déjà la preuve irréfutable de l’exact même pouvoir.