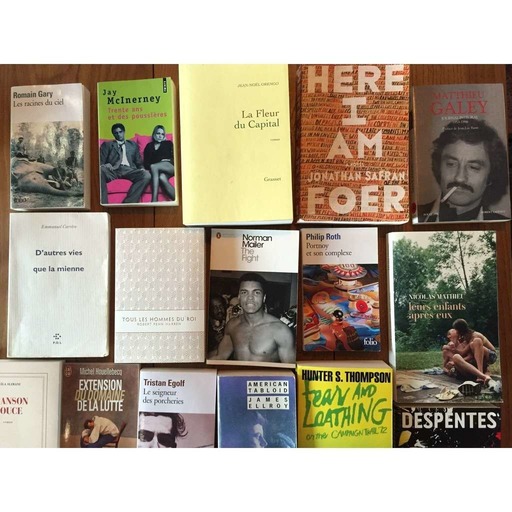Là où j’ai grandi, la végétation était un décor, taillé de si près qu’il me semblait artificiel. Devant la maison, une pelouse rase s’étendait de part et d’autre de l’allée de graviers. Sagement plantés le long de la haie, à intervales réguliers – seul un taillis, à droite de l’allée, faisait exception – quelques arbres étendaient de maigres ramages. Leur intérêt premier était de faire des cages de foot acceptables. Sous la fenêtre du salon, le massif de tulipes et de pensées, au motif régulier comme un formulaire Cerfa, n’aurait guère déparé sur un morne rond-point. De l’autre côté de la maison, un haut cerisier s’élevait, déplumé et solitaire, entre la 2CV et la R20 de mes parents. Une ouverture dans son tronc avait été colmatée avec du ciment. Le jardinier responsable de toute cette luxuriante féerie s’appelait – vraiment – Francisque Bataille.
(...)
Je vous imagine, à ce stade, remonter en tête du présent article pour vérifier son titre. Mais oui, les 426 mots qui précèdent ont tout à voir avec L’arbre monde, de Richard Powers, Grand Prix de littérature américaine 2018. Comme le répète Adam, personnage clé de ce roman choral de 533 pages, « Les meilleurs arguments du monde ne feront jamais changer d’avis. Pour ça, ce qu’il faut, c’est une bonne histoire ». Alors que, depuis des décennies, les preuves formelles des cataclysmes en cours sont agitées sous les yeux de toute personne dotée d’un cerveau qui fonctionne, elle garde de bonnes chances de s’en contrefoutre. Le génie de Richard Powers consiste donc à utiliser la forme romanesque là où la non-fiction a si longtemps échoué.