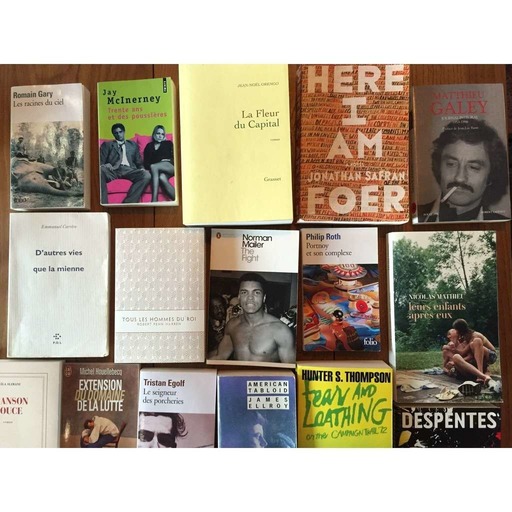Walsall, début des années 60, au cœur des West Midlands. On surnomme cette région industrielle à l’accent épais le Black country. Pour gagner son école à pied, un môme doit passer à proximité d’une gigantesque fonderie. L’air vicié qu’elle recrache jour et nuit le fait suffoquer, comme il souille les draps qu’on étend dans les jardins alentour. Suffoquer fera longtemps partie du quotidien de ce gamin, même devenu chanteur de l’un des plus grands groupes de heavy metal au monde : il devra presque attendre jusqu’à la cinquantaine pour enfin oser faire son coming-out.
On tient là une intrigue romanesque en diable : si le rockeur peinant à affronter ses démons relève du stéréotype, la collision entre un monde du rock extrême réputé puissamment machiste et le tabou toujours vivace de l’homosexualité au XXe siècle apporte une originalité certaine à cette autobiographie. Car Rob Halford existe bien, même si sa notoriété en France après 50 ans de carrière, comme celle de son groupe Judas Priest, demeure largement restreinte à la tribu des hardos. Le Priest, c’est une glorieuse sidérurgie musicale, un son lourd et métalliquement pur au service de gros riffs entêtants qui lorgnent vers leurs voisins de Birmingham, les pionniers de Black Sabbath. Mais c’est aussi, comme les cousins londoniens d’Iron Maiden, des accélérations qui vous collent au fauteuil, le dialogue entre deux guitares lead se partageant solos et mélodies, et une signature vocale extraordinaire. En termes génétiques Rob Halford est une harpie, la stridence de ses hurlements l’atteste, capable toutefois d’adapter avec talent sa voix à quantité de registres plus humains – le tout avec un phrasé aussi British qu’une part de Christmas pudding.